Niveau des lésions des voies visuelles
Afin de pouvoir discuter, sur une base commune, des particularités de l'examen fonctionnel et du diagnostic de déficience visuelle d'origine cérébrale, il est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble des voies visuelles.
Lors de beaucoup de conférences internationales, le chapitre des voies visuelles a été le plus difficile à aborder. C'est pourquoi nous avons réalisé des schémas simplifiés des voies visuelles destinés au "Manuel d'examen de la vue". Le lecteur devrait lui-même dessiner ces voies visuelles aussi souvent que nécessaire pour que leur structure lui soit tout à claire. Sans cela, il est trop difficile de comprendre comment une lésion peut affecter la fonction.
Avant d'essayer de faire un examen fonctionnel ou une évaluation clinique de la vision d'un enfant, il nous faut essayer d'avoir une image claire de l'anatomie de la lésion.

Faites des copies de ces schémas (PDF-file) pour vous entraîner à dessiner les voies visuelles.
Les schémas suivants montrent les parties principales des voies visuelles, vues du de profil.
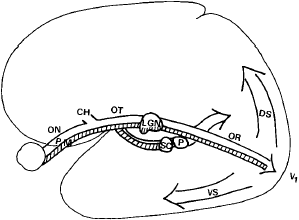 La voie destinée à la vision consciente va de la rétine au corps genouillé latéral (CGL), puis au cortex visuel primaire (V1). La voie tectale, sous corticale, transfère l'information vers le colliculus supérieur (CS), vers de nombreux noyaux du tronc cérébral, et, par le pulvinar (PU) vers les fonctions visuelles associatives. Du cortex (V1), l'information remonte vers le haut, voie dorsale, et descend vers le lobe inféro temporal, voie ventrale. Les lésions, selon leur situation, sont à l'origine de pertes fonctionnelles différentes. Les deux types principaux de fibres nerveuses au niveau du nerf optique sont les fibres parvo (P) et magnocellulaires (M).
La voie destinée à la vision consciente va de la rétine au corps genouillé latéral (CGL), puis au cortex visuel primaire (V1). La voie tectale, sous corticale, transfère l'information vers le colliculus supérieur (CS), vers de nombreux noyaux du tronc cérébral, et, par le pulvinar (PU) vers les fonctions visuelles associatives. Du cortex (V1), l'information remonte vers le haut, voie dorsale, et descend vers le lobe inféro temporal, voie ventrale. Les lésions, selon leur situation, sont à l'origine de pertes fonctionnelles différentes. Les deux types principaux de fibres nerveuses au niveau du nerf optique sont les fibres parvo (P) et magnocellulaires (M).
- En cas de lésion du nerf optique, l'atteinte fonctionnelle est unilatérale, du côté de l'œil atteint.
En cas de lésion proche du chiasma (CH) au niveau des bandelettes optiques, il y a amputation du champ visuel du côté opposé. Si les deux bandelettes sont lésées, le sujet n'a pas de perception visuelle mais un rythme diurne lié à la lumière est encore possible, à condition que l'information puisse parvenir à la glande pinéale par le petit noyau supra chiasmatique (noyau situé au-dessus du chiasma).
Quand la lésion est située dans les bandelettes près du corps genouillé latéral, l'information visuelle peut être transmise aux fonctions cérébrales par la voie tectale. Il semble que cette voie ne puisse emprunter que la voie dorsale, vers les fonctions visuelles pariétales en relation avec l'espace visuel égocentrique et allocentrique et avec l'oculomotricité.
Au niveau des radiations optiques (RO), il est rare que la voie optique soit lésée en totalité : le plus souvent il existe de petites lésions entraînant une perte de fibres localisée en "fromage de Gruyère" qui correspond à une amputation inégale du champ visuel.
Quand la lésion est située au niveau du cortex visuel, elle aboutit à l'amputation d'une partie ou d'une moitié du champ visuel controlatéral. Des modifications métaboliques diffuses peuvent entraîner la perte d'un certain type d'information sans déficit permanent du champ visuel.
Quand l'atteinte touche l'analyse visuelle secondaire ou supérieure, elle entraîne, non pas un déficit du champ visuel, mais la perte de fonctions spécifiques. L'atteinte de la voie temporale ou ventrale, est à l'origine d'agnosies, de la perte de diverses fonctions de reconnaissance ; l'atteinte de la voie dorsale, pariétale entraîne une altération des fonctions visuomotrices et oculomotrices, ainsi que de l'orientation égocentrique et allocentrique. L'apraxie visuelle est une entité clinique rare due à une atteinte de cette partie des voies visuelles.
Les fonctions de la voie visuelle ventrale sont parfois appelées les fonctions "what", alors que les fonctions de la voie visuelle dorsale sont les fonctions "where". C'est une simplification excessive car nous devons reconnaître notre environnement pour nous y orienter, même si, lors du mouvement, nous n'analysons pas en détail cet environnement ni la structure des parties en mouvement de notre corps. Les deux types de fonctions sont liés et s'appuient sur l'information fournie par notre mémoire visuelle.
Les voies visuelles transportent différents types d'information visuelle par différentes fibres nerveuses. Les fibres P, parvocellulaires, transportent l'information de la couleur et du détail noir et blanc à contraste élevé. Les fibres M, magnocellulaires, transportent l'information du mouvement et des faibles contrastes noir et blanc. Cette dichotomie est déjà présente au niveau des photorécepteurs rétiniens.
Du fait de la présence, typique du système visuel, de voies et de fonctions fonctionnant en parallèle, certaines fonctions visuelles peuvent être perdues ou altérées par une lésion tandis que d'autres restent normales.
L'histoire de la maladie et les techniques d'imagerie courante donnent des informations suffisantes pour démarrer l'examen sur de bonnes bases. Dans les pays en voie de développement, l'évaluation doit être basée sur un interrogatoire soigneux et détaillé, un examen clinique général, un examen ophtalmologique si possible et sur les observations que nous allons maintenant exposer.
Quand nous rédigeons nos observations sur la fonction visuelle d'enfants et d'adultes, nous devons avoir clairement à l'esprit cette variation de la taille et de la localisation des lésions des voies visuelles. On oublie trop facilement les lésions des voies visuelles lorsqu'il existe une atteinte concomitante des globes oculaires. Et pourtant, beaucoup d'enfants ayant par exemple une rétinopathie du prématuré ont des troubles de la perception plus graves que les séquelles de la pathologie rétinienne.
L'exploration des fonctions corticales et sous corticales est un élément essentiel de l'examen fonctionnel. Les questions à poser sont les suivantes : dans quelle mesure le déficit visuel affecte-t-il
- les possibilités de communication de l'enfant
Y a t-il d'autres déficits fonctionnels agissant dans le même sens? - ses capacités d'orientation dans l'espace
Y a t-il d'autres déficits fonctionnels agissant dans le même sens? - ses activités de la vie journalière
Y a t-il d'autres déficits fonctionnels agissant dans le même sens? - le maintien d'une vision de près soutenue
Y a t-il d'autres déficits fonctionnels agissant dans le même sens?
Ces différentes atteintes peuvent être diversement associées et de gravité variable. A un extrême, certains enfants reçoivent des informations visuelles si chaotiques qu'ils ont tendance à ne pas du tout les utiliser. A l'autre extrême, des modifications d'une fonction de reconnaissance, une agnosie isolée identifiée par un interrogatoire et un examen clinique très soigneux, semblent ne pas retentir sur le comportement général de l'enfant. De même, les atteintes associées, motrices, sensorielles, les troubles de la mémoire associés sont très variables. Enfin un retard du développement cognitif, une affection psychiatrique peuvent venir compliquer le tableau.
Chez un certain nombre d'enfants, les expériences visuelles ne semblent pas gratifiantes ; l'enfant ne semble pas éprouver de plaisir à regarder les objets. Ce phénomène a été décrit chez des adultes atteints de troubles neurologiques secondaires à un accident vasculaire du tronc cérébral ; il peut durer des mois. Si une telle lésion survient chez un enfant qui, pour cette raison, n'éprouve pas de plaisir à utiliser sa vision, celle-ci ne fonctionnera pas avec la même force impérieuse que chez un enfant normal. Quelle est la fréquence de ce problème chez les enfants qui ne montrent pas d'intérêt à regarder les objets, nous ne pouvons pas le deviner.
Le fait de regarder est une fonction spécifique qui suppose que l'on dirige son attention vers l'objet. Si cette fonction est déficitaire, l'enfant ne pose pas son regard sur l'objet, mais le laisse flotter d'un côté à l'autre. Un tel déficit est également difficile à diagnostiquer avec certitude. Il ne faut pas le confondre avec une difficulté de mise au point par insuffisance d'accommodation. La mesure du pouvoir accommodatif ne fait pas partie de l'examen ophtalmologique de routine ; il est pourtant souvent possible d'évaluer simplement la différence de réfraction en vision de près et en vision de loin en manipulant un objet qui intéresse l'enfant. Au moindre doute, on essaiera de voir si le port de lentilles convexes modifie son comportement.
On considère souvent à tort que les caractéristiques autistiques font partie du tableau de déficience visuelle d'origine centrale. Il peut effectivement y avoir d'authentiques caractéristiques autistiques, mais dans un certain nombre de cas, le diagnostic est basé sur une interprétation erronée du comportement visuel de l'enfant. Le fait que l'enfant ne maintienne pas la fixation sur son interlocuteur mais laisse errer son regard peut faire porter à tort le diagnostic d'autisme par quelqu'un qui n'est pas familier du problème visuel. De la même façon, un enfant qui utilise sa fixation excentrique dirige son regard, non pas vers les yeux de son interlocuteur mais plus haut, en général au niveau de la ligne des cheveux ou un peu au-dessus ; il ne faut pas croire qu'il "évite le contact oculaire". Enfin, un enfant dont l'accommodation est perturbée semble ne pas fixer le visage de son vis à vis mais regarder au travers, et ce comportement peut aussi être confondu avec un trait autistique.
Avant de commencer l'examen, nous devons étudier en détail le comportement de l'enfant. Les enfants atteints de déficience visuelle d'origine centrale ont de nombreux points communs, diversement associés en fonction du siège des lésions. Les observations faites par les parents, les thérapeutes, les enseignants sont réunis dans un questionnaire recouvrant les aspects suivants du comportement de l'enfant :
- le comportement visuel est variable : c'est la caractéristique la plus fréquemment retrouvée
- l'enfant compense son déficit visuel par un développement précoce du langage
- il le compense aussi par la mémoire
- il préfère parler avec un adulte que jouer dans un groupe d'enfants
- il évite les foules, et s'accroche à ses parents ; il redoute en particulier les plages et les piscines où la reconnaissance des visages est difficile
- il commence à dessiner et à peindre tard ou pas du tout
- il utilise plus la couleur que les autres enfants
- il s'intéresse peu à la télé et aux bandes dessinées
- il montre des signes de difficultés dans l'espace, s'arrêtant au niveau des escaliers et des ombres portées
- parfois, il a appris les lettres et les chiffres très tôt, mais ne parvient pas à lire autre chose que des mots courts
- il fait appel à ses frères et sœurs ou à ses parents dans les activités exigeant un effort visuel trop important
- il se fâche lorsqu'on lui déplace même très peu ses jouets ou ses vêtements
Il faut poser ces questions lors d'entretiens avec les parents, les thérapeutes, les enseignants plutôt que de faire remplir des questionnaires pré imprimés. Ce serait d'ailleurs un grand progrès si ces questions pouvaient être posées dans les services de strabologie, où l'on traite beaucoup d'enfants sans s'apercevoir qu'ils ont une atteinte importante des fonctions visuelles supérieures.
Les techniques de compensation utilisées avec succès en maternelle s'avèrent inefficaces pour l'apprentissage de la lecture et du calcul. L'école primaire devient souvent un lieu de déception et de détresse pour un enfant qui, jusque là, apprenait avec enthousiasme.